Depuis quelques semaines, le gouvernement affiche sa volonté de réduire les droits à l’indemnisation chômage pour les salariés ayant conclu une rupture conventionnelle, au prétexte que ces dispositifs « coûteraient trop cher » à l’assurance chômage (lire pour plus de détails mon article sur Actu-Juridique.fr . Ce discours s’appuie sur une série de chiffres mis en avant par la Ministre du Travail. Mais à y regarder de plus près, ces données sont incomplètes, voire instrumentalisées.
Une note de l’UNEDIC détournée de son usage initial
La justification principale de cette réforme repose sur une note technique de l’UNEDIC datée de février 2024. Or, cette note n’a pas été élaborée pour soutenir une décision politique ni pour évaluer de manière ciblée le coût spécifique des ruptures conventionnelles.
Il s’agit d’un document de travail, à vocation strictement statistique, destiné à analyser les effets des réformes de l’assurance chômage entre 2019 et 2021. Les données qu’elle exploite proviennent du Fichier National des Assedic (FNA) – un outil validé par la CNIL uniquement à des fins d’évaluation, de recherche ou de simulation. En aucun cas, ces données ne peuvent servir de base pour orienter ou justifier une politique publique de l’indemnisation chômage. Et pourtant, c’est exactement ce qu’il se passe.
Des données obsolètes et une lecture tronquée
La Ministre du Travail cite notamment deux tableaux de cette note pour affirmer que les ruptures conventionnelles représenteraient 25 % des dépenses d’indemnisation :
Un autre tableau établissant que les ruptures conventionnelles ont représenté 9 milliards d’euros de dépenses, contre 11 milliards pour les licenciements et 1 milliard pour les démissions dites « légitimes ».
Mais ces chiffres, tirés de données de 2022, sont déjà dépassés. Ils ne prennent pas en compte l’évolution récente du marché du travail, ni les ajustements déjà réalisés sur les règles d’indemnisation.
Une catégorie statistique trompeuse : les « ruptures amiables »
La note de l’UNEDIC utilise la dénomination « ruptures amiables », catégorie statistique regroupant plusieurs types de séparations contractuelles :
- les ruptures conventionnelles à proprement parler ;
- les ruptures amiables des contrats d’apprentissage ;
- les adhésions au contrat de sécurisation professionnelle (CSP), souvent proposées dans un cadre de licenciement économique.
Ces situations, bien que toutes « amiables » dans leur forme, recouvrent des réalités juridiques et économiques très différentes, et n’engendrent pas les mêmes mécanismes d’indemnisation ni les mêmes enjeux.
Et pourtant, le gouvernement utilise cette note, la détourne sans nuance pour justifier une réforme qui vise uniquement la rupture conventionnelle, alors même que les donnée ne permettent pas de l’isoler avec précision. Cette interprétation erronée entretient la confusion entre les dispositifs, et gonfle artificiellement le poids supposé de la rupture conventionnelle dans les dépenses de l’assurance chômage.
Ce que la ministre ne mentionne pas : les statistiques sur les ouvertures de droits.
Un autre tableau de la même note de l’UNEDIC, ignorée volontairement par le gouvernement, montre la répartition des ouvertures de droits à l’assurance chômage, ce qui est intéressant car les conclusions ne pourront pas être les mêmes sur la rupture conventionnelle :
- 18 % concernent les ruptures conventionnelles,
- 20 % les licenciements,
- et 24 % les contrats d’apprentissage.
Autrement dit, les ruptures conventionnelles ne sont pas surreprésentées dans les ouvertures de droit. En revanche, certains dispositifs comme l’apprentissage font l’objet d’un usage opportuniste : de nombreux contrats se terminent sans embauche, permettant aux employeurs de bénéficier des aides publiques sans jamais embaucher, laissant leurs anciens apprentis « pointer » au chômage.
Pourquoi les ruptures conventionnelles « coûtent » plus cher ?
Il est vrai que les ruptures conventionnelles ont un coût moyen d’indemnisation plus élevé. Tout simplement car ce type de rupture concerne majoritairement des cadres, aux rémunérations plus élevées, donc aux droits plus importants. Rien d’anormal à ce que les indemnités soient plus conséquentes dans ces cas.
Ce surcoût relatif n’est ni un abus, ni un dysfonctionnement, mais le simple reflet du système contributif de l’assurance chômage : on cotise selon son salaire, on est indemnisé en fonction de celui-ci.
Une tendance en baisse… celle des ouvertures de droits à l’assurance chômage (passée sous silence par le gouvernement).
Dernier point fondamental : les ouvertures de droits à l’assurance chômage ont baissé de 14 % en 2023, selon les données officielles de l’UNEDIC.
Ce chiffre signifie que sans aucun doute l’indemnisation des chômeurs qui ont quitté leur emploi à l’aide d’une rupture conventionnelle sont moins nombreux à être indemnisés.
Le gouvernement, au lieu de s’en réjouir et de communiquer sur cette bonne nouvelle stigmatise le chômeur qui est même soupçonné d’utiliser ces indemnités chômage pour voyager. (le fameux mythe du chômeur voyageur).
En conclusion
Il est impératif de revenir à une lecture honnête, rigoureuse et complète des données.
Les chiffres utilisés pour justifier cette réforme ne sont pas à jour, la note de l’UNEDIC est détournée de sa finalité initiale et ne peut pas être considérée comme une statistique fiable, elle n’était pas destinée à étudier le coût des rupture conventionnelle.
La réalité des chiffres relatifs aux ouvertures de droits (au chômage)ne confirme pas le récit alarmiste du gouvernement.
La catégorie « ruptures amiables », issue de la note de l’UNEDIC, concerne des situations très différentes, ce qui ne permet pas d’isoler la rupture conventionnelle.
L’UNEDIC annonce une baisse globale des entrées dans l’assurance chômage.
Malgré cette baisse, on s’attaque aux droits des demandeurs d’emplois, alors que l’on pourrait très bien s’intéresser aux abus en matière d’apprentissage, des aides sont accordées sans contreparties aux employeurs qui utilisent ces contrats comme de la main d’œuvre « pas chère », laissant leurs apprentis, à la fin de leur contrat, aux mains de l’UNEDIC .
Et si on s’attaquait plutôt aux aides accordées aux entreprises, il y a peut-être des économies à trouver !






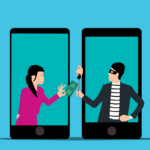
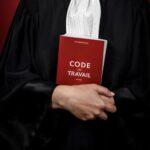


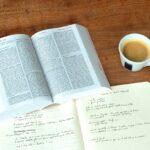

Serres Séverine
28 juillet 2025 — 21:29
Analyse intéressante et a priori juste à l’exception du premier point : une statistique prévue pour l' »évaluation » d’un dispositif sert nécessairement à l’évaluation de la politique publique que le dispositif légal organise.
A part ça bravo et merci pour votre analyse, je la relaie sur le fil X de la FEDJF.
A bientôt,
Severine Serres