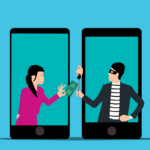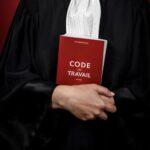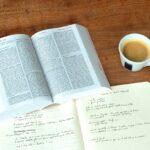La loi sur la modernisation du marché du travail, adoptée le 25 juin 2008, introduit un nouveau mode de rupture du contrat de travail : la rupture conventionnelle. Elle est une reprise pour grande partie d’un accord entre les partenaires sociaux (ANI- accord national interprofessionnel). Ce nouveau mode de rupture permet de se séparer à l’amiable, d’une manière apaisée.
En 2008, la presse le compare au divorce par consentement mutuel.
Le salarié bénéficie d’une autre possibilité que la démission pour partir d’une entreprise, sans risquer la précarité, car il percevra le chômage si cette rupture est acceptée par l’employeur et homologuée par la direction départementale du travail.
C’est la gauche qui a revendiqué ce droit au chômage puisque le projet de loi ne le prévoyait pas, contrairement à l’accord des partenaires sociaux.
L’employeur, quant à lui, ne sera pas contraint de licencier un salarié et de motiver ce licenciement.
Il pourra se séparer amiablement de son salarié, par cette rupture sécurisée qui ne peut être contestée que dans un délai d’un an et uniquement en invoquant un vice du consentement, difficile, voire impossible, à prouver.
En 2009, le Ministre du Travail, Xavier Bertrand se félicitait du succès de la rupture conventionnelle : « (..) cette réforme correspondait à une vraie demande, à la fois de sécurité juridique pour les entreprises et de sécurisation des parcours professionnels pour les salariés ». (Nouvel Obs 18 décembre 2008, 14 000 ruptures de contrat à l’amiable »).
En 2023, alors que la rupture conventionnelle a presque 15 ans, elle traverse une crise d’adolescence compliquée.
Le salarié, un profiteur ?
Elle serait détournée par les salariés séniors qui utiliseraient la rupture conventionnelle comme une sorte de préretraite.
Le forfait social sur cette rupture conventionnelle est augmenté.
Elisabeth Borne menace de la faire disparaître car elle coûte trop cher.
La Ministre du travail, Catherine Vautrin arrête la crise, rassure les syndicats d’employeurs et assure que la disparition de la rupture conventionnelle n’est pas d’actualité.
Les salariés et les employeurs continuent de divorcer à l’amiable et oublient que ce mode de rupture a failli disparaître.
En juin 2025, la rupture conventionnelle fête ses 17 ans, elle est presque majeure et le gouvernement lui réserve un très beau cadeau pour ses 18 ans. Pour le vote du budget 2026, elle sera la reine de l’assemblée, car elle est dans le viseur du gouvernement qui souhaite durcir les conditions d’accès à la rupture conventionnelle en explorant des pistes telles que le différé allongé pour percevoir le chômage ou la limitation de la rupture à certains profils de salariés.
Le salarié est décrit dans certains reportages des chaines d’information continue comme le profiteur du système, comme celui qui détourne la rupture conventionnelle, la demande systématiquement pour éviter de démissionner. Il est question de démissions déguisées et on oublie que les licenciements déguisés existent aussi.
Il faut le souligner, la rupture conventionnelle est très avantageuse pour l’employeur. Il peut rompre sans avoir à respecter de préavis, pour les contrats de travail d’un cadre, cela peut être intéressant puisqu’il pourra partir à l’expiration du délai de réflexion et d’examen de la demande rupture conventionnelle par l’inspection du travail, soit dans un délai d’un mois après la signature de la rupture conventionnelle. Rappelons que le préavis des cadres est la plupart du temps d’une durée de trois mois, l’employeur économise donc deux mois de salaire. De même, nombre d’employeurs qui acceptent de signer une rupture conventionnelle demandent au salarié de poser ses congés payés durant le délai de réflexion et l’examen par l’inspection du travail afin d’éviter de régler une indemnité de congés payés dans le cadre du reçu pour solde de tout compte. Par ailleurs, elle est sécurisée pour l’employeur qui voudrait se séparer d’un salarié peu performant autrement que par le licenciement.
Le salarié, quant à lui, s’il conclut une rupture conventionnelle, peut bénéficier des allocations chômage et éviter de démissionner. Il peut partir d’une entreprise en bénéficiant de son indemnité de rupture conventionnelle qui correspond à son indemnité de licenciement, une sorte de reconnaissance du travail effectué. Il est même possible de négocier une indemnité supra légale dans le cadre d’un harcèlement moral ou d’exécution déloyale du contrat de travail.
L’abus de rupture conventionnelle, un faux débat
Pour lire la suite, rendez-vous sur Actu-Juridique.