article mis à jour le 21 octobre 2025
1. Qu’est-ce que le syndrome d’aliénation parentale (SAP) ?
Vous vous interrogez peut-être sur ce qu’est le « syndrome d’aliénation parentale ».
Selon la définition donnée sur Wikipédia :
« Le syndrome d’Aliénation Parentale (abrégé en SAP) est une notion introduite par Richard A. Gardner au début des années 1980, faisant référence à ce qu’il décrit comme un trouble dans lequel un enfant, de manière continue, rabaisse et insulte un parent sans justification. Selon Gardner, ce syndrome apparaîtrait en raison d’une combinaison de facteurs, comprenant l’endoctrinement par l’autre parent (presque exclusivement dans le cadre d’un conflit sur la garde de l’enfant) et les propres tentatives de l’enfant de dénigrer le parent ciblé. »
Gardner a introduit ce terme dans un article publié en 1985, décrivant un ensemble de symptômes qu’il avait observés au début des années 1980. Wikipédia+1
Cette notion a été relayée en France, notamment par le psychiatre et expert judicaire Paul Bensussan (ouvrage Parental aliénation, DSM-5 and ICD-11, 2010). Wikipédia
Cependant, dès l’origine, le SAP a suscité des critiques : sur son assise scientifique, sur sa fiabilité, et sur l’usage qui en était fait dans les contentieux de séparation parentale.
2. L’essor jurisprudentiel du SAP (syndrome d’alinéation parentale) en France
2.1 Une reconnaissance initiale
La France ne figure pas parmi les premiers pays à reconnaître clairement le SAP. Toutefois, on peut noter quelques jalons :
-
Un arrêt de la Cour de cassation (1re civ., 26 juin 2013, n° 12-14.392) a reconnu que « le syndrome d’aliénation parentale installé dans la vie de l’enfant » pouvait conduire à un transfert de résidence de la mère au père.
-
Avant cela, des décisions de TGI ou de CA avaient admis l’existence d’un processus d’aliénation parentale, par exemple la CA de Bordeaux du 3 octobre 2006 (« le refus persistant et non motivé d’une mère de respecter le droit de visite judiciairement fixé du père est de nature à entraîner le changement du lieu de résidence »).
Cette phase d’acceptation relativement favorable au concept du SAP a pu conduire à penser qu’il allait devenir un outil juridique usuel pour les juges aux affaires familiales.
2.2 Une jurisprudence qui a évolué.
Des décisions plus récentes ont confirmé que les tribunaux acceptent de traiter des situations qualifiées d’aliénation parentale, ou du moins de manipulation parentale, d’emprise sur l’enfant, de conflit de loyauté. Par exemple, l’arrêt de la Cass. 1re civ., 16 novembre 2022, retient que « la conflictualité exacerbée par un parent à l’égard de l’autre, et l’instrumentalisation à outrance de l’enfant commun » constituent un motif de retrait de l’autorité parentale.
On trouve également des arrêts de CA (CA de Nîmes, 13 avril 2022) où l’on constate que la mère avait « par ses manœuvres répétées et systématiques pour associer ses enfants à sa volonté d’éliminer le père … » un comportement qualifié d’aliénation parentale grave.
L’ensemble montre que les juridictions françaises ont progressivement accédé à la réalité des processus dans lesquels un enfant est pris entre parents en grave conflit, et que ces conflits dépassent le simple « droit de visite refusé ».
Décision CEDH, 24 juin 2025 (n° 61347/21, DG et SG c/ Serbie)
Dans cette décision récente, la Cour européenne des droits de l’homme condamne la Serbie pour violation de l’article 8 de la Convention, après le maintien injustifié d’un enfant de trois ans en famille d’accueil sans contrôle judiciaire immédiat ni organisation régulière de contacts avec ses parents.
La CEDH reproche aux autorités nationales un manque total d’efforts pour favoriser la réunification familiale, estimant qu’une « aliénation complète » de l’enfant à l’égard de ses parents a été provoquée (§ 188, § 194).
L’emploi du terme « aliénation » par la Cour, bien que sans référence au « syndrome » de Gardner, témoigne d’une reconnaissance du phénomène d’éloignement ou de coupure affective entre l’enfant et ses parents, tout en s’inscrivant dans un cadre de protection de la vie familiale garanti par la Convention.
Cette décision illustre la tendance des juridictions européennes : admettre la réalité de l’aliénation comme fait relationnel, sans valider pour autant le concept médical de “syndrome d’aliénation parentale”.
Elle prolonge la ligne jurisprudentielle amorcée par les arrêts Strand Lobben c/ Norvège (CEDH, 10 sept. 2019) et Pisica c/ République de Moldavie (CEDH, 29 oct. 2019).
3. Le tournant : remise en cause du SAP (syndrome d’aliénation parentale) et recentrage sur d’autres notions
3.1 Le signalement du ministère de la Justice (2018)
En mars 2018, le ministère de la Justice a diffusé une circulaire / dépêche alertant les juges aux affaires familiales sur le « caractère particulièrement controversé » du concept de SAP, et rappelant la possibilité de recourir à d’autres dispositifs, notamment les notions d’« emprise parentale », de « conflit de loyauté », de « conflit parental ».
La dépêche précisait :
« … lorsqu’un syndrome d’aliénation parentale est invoqué par les parties, les juges peuvent demander à un expert d’évaluer les éventuels mécanismes d’emprise que peut exercer le parent sur l’enfant … »
L’examen de la jurisprudence civile postérieure montre d’ailleurs que les magistrats « n’ont pas recours au syndrome d’aliénation parentale pour motiver leurs décisions … mais aux concepts de conflit de loyauté, de conflit parental ou d’emprise ».
C’est un premier signe que la notion de SAP commence à être marginalisée.
3.2 La résolution du Parlement européen et la réponse ministérielle de décembre 2024
En octobre 2021, le Parlement européen, dans une résolution relative aux conséquences des violences conjugales et des droits de garde sur les enfants, a expressément invité les États membres à ne pas reconnaître le SAP dans leur pratique judiciaire et leur droit, au motif que deux institutions majeures en santé mentale (l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et l’American Psychological Association) rejettent cette notion pour sa faible assise scientifique : « … ces notions peuvent être employées au détriment des victimes de violence pour remettre en cause leurs aptitudes parentales, écarter leurs propos et faire abstraction de la violence à laquelle les enfants sont exposés. »
Puis, dans une réponse ministérielle en date du 12 décembre 2024, le ministère de la Justice a confirmé que le « syndrome d’aliénation parentale » ne fait pas l’objet d’un consensus médical, qu’il n’est pas retenu par l’OMS, et que les magistrats recourent désormais aux concepts de « conflit de loyauté », « conflit parental » ou « emprise » :
« Il doit être souligné que le concept d’aliénation parentale est controversé et non reconnu par la communauté scientifique dans les référentiels de la psychiatrie … »
Cette réponse ministérielle marque un tournant : la notion de SAP, autrefois encore invoquée, est désormais clairement mise en recul, voire disqualifiée dans les pratiques judiciaires et expertes.
3.3 Ce que cela signifie concrètement
-
La notion de SAP ne bénéficie plus du même crédit et n’apparaît plus comme référence systématique dans les jugements.
-
Les juges aux affaires familiales privilégient aujourd’hui des notions plus neutres ou scientifiquement mieux établies : « emprise parentale », « campagnes de dénigrement », « conflit de loyauté » ou encore « instrumentalisation de l’enfant ».
-
La reconnaissance qu’un enfant puisse être « aliéné » par un parent ne passe plus automatiquement par le label SAP : l’analyse se fait cas par cas, selon les preuves de manipulation, l’intérêt de l’enfant, l’existence ou non de violences, etc.
-
Le phénomène est désormais davantage traité dans le cadre de la protection de l’enfance, de la violence psychologique, ou du droit de visite refusé plutôt que comme « syndrome » à part entière.
4. Pourquoi la remise en cause de la notion de « syndrome d’aliénation parentale » ?
Plusieurs raisons expliquent ce recul :
-
Absence de « consensus scientifique » : Le SAP n’est pas inscrit dans les grandes classifications internationales (le DSM-5 ou l’ICD-11) et son existence comme « syndrome » distinct reste controversée.
-
Risques d’abus ou de détournement : Certains critiques dénoncent que l’invocation du SAP puisse servir à discréditer un parent dénonciateur de violences (conjugales ou sexuelles) en le qualifiant à tort de « parent aliénant ».
-
Évolution des enjeux juridiques et sociétaux : On privilégie désormais la protection de l’enfant, l’évaluation de son intérêt, la détection de violences ou d’emprise plutôt que l’usage d’un terme polémique.
-
Jurisprudence et textes officiels : la circulaire de 2018 et la réponse de 2024 du ministère ont formalisé ce recul dans les pratiques.
-
Complexité de la preuve et des mécanismes : Le processus décrit par Gardner (endoctrinement, rejet « sans justification », etc.) s’avère difficile à appliquer comme critère unique, notamment lorsqu’il peut y avoir des violences, des déménagements parentaux, un éloignement géographique ou des refus de visite motivés par de véritables raisons.
- Influence des instances européennes : la jurisprudence de la CEDH (notamment l’arrêt du 24 juin 2025) renforce l’idée d’un traitement équilibré entre protection de l’enfant et respect du droit familial.
5. Conseils pratiques pour les parents
-
Si vous êtes parent concerné, il est important :
-
de documenter les faits : refus non justifié de visite, propos dénigrants, isolations, expertises, etc.
-
de solliciter un avocat en droit de la famille, qui saura recommander l’orientation vers une expertise psychologique ou une enquête sociale.
-
de ne pas invoquer systématiquement le « syndrome d’aliénation parentale » comme tel : les juges aux affaires familiales préfèrent aujourd’hui d’autres notions et vont plutôt analyser les faits sous l’angle de l’intérêt de l’enfant
-
6. En résumé
Le syndrome d’aliénation parentale (SAP) est une notion théorisée dans les années 1980 et longtemps utilisée dans les contentieux de séparation parentale. En France, la jurisprudence a franchi des étapes de reconnaissance (notamment l’arrêt de la Cour de cassation du 26 juin 2013) pour admettre que l’enfant pouvait être instrumentalisé par un parent.
Mais depuis quelques années, on assiste à un recul de la notion de SAP : la communauté scientifique reste très réservée sur son existence comme syndrome autonome, le ministère de la Justice a pris position en 2018 puis en 2024 pour recommander aux juridictions de ne plus se fonder sur cette expression, et les juges aux affaires familiales privilégient désormais d’autres notions mieux étayées.
Ainsi, le phénomène de l’aliénation parentale n’a pas « disparu », loin s’en faut : mais la terminologie change, et l’approche se recentre sur la protection de l’enfant, l’évaluation de l’emprise parentale, le droit de visite et l’exercice de l’autorité parentale dans l’intérêt de l’enfant.
L’arrêt CEDH du 24 juin 2025 vient conforter cette évolution : la Cour y constate une “aliénation complète” de l’enfant, tout en réaffirmant que l’intérêt supérieur de l’enfant et le droit au maintien des liens familiaux priment sur toute catégorisation pseudo-clinique.
Vous pouvez écouter aussi:



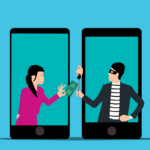
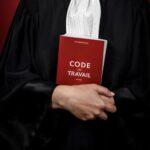


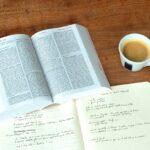

Catherine VIGUIER
29 avril 2014 — 12:00
« Cette notion a déjà été prise en compte, mais pas systématiquement, le plus efficace est de demander une expertise psychiatrique.
Les experts savent bien montrer les souffrances et troubles dans les cas d’aliénation parentale. »
yen
25 juillet 2017 — 18:05
Le Syndrome d’Aliénation Parentale a été inventé en 1985; Gardner a diffuser en la publiant à compte d’auteur et jamais soumises à l’évaluation par ses pairs. Malgré une levée de boucliers de la part de chercheurs sérieux, ses influentes théories ont provoqué une multitude de catastrophes judiciaires conduisant même des enfants au suicide. Gardner,avait usurpé le titre de professeur de psychiatrie.
– De nombreux chercheurs ont conclu que la plupart des écrits de Gardner étaient fortement misogynes, axés sur la malveillance et la pathologisation des mères. Mais Gardner considérait aussi que la société avait « une attitude excessivement punitive et moralisatrice envers les pédophiles », et estimait que la société devait reconnaître leur « rôle fondamental pour la survie de l’espèce humaine ». Gardner s’est suicidé en se lardant de coups de couteau en 2002. le « SAP/AP » vient à nouveau d’être refusé d’inclusion dans la nouvelle mouture du DSM V et n’est PAS reconnu par l’Organisation Mondiale de la Santé. Pour d’ autre fervent defenseur du sap Hubert Van Gijseghem, pense que « trop écouter et judiciariser la parole de l’enfant peut avoir des conséquences plus graves que l’abus lui-même ». Auditionné devant le comité de la Chambre des communes canadienne, au sujet d’un projet de loi voulant durcir les peines des prédateurs sexuels, Van Gijseghem a surpris son auditoire en soutenant que la « pédophilie » était une orientation sexuelle au même titre que l’hétérosexualité ou l’homosexualité. Le SAP a été interdit d utilisation dans les tribunaux dans de nombreux pays Espagne en 2010, aux états unis et en Australie les experts et magistrats qui ont propagé cette théorie ont été sanctionné. Il parait difficile d’accuser tout à la fois les femmes d’être fusionnelles : ce qui entend qu’elles sont incapables de dire non à leur enfant ( la relation « fusionnelle » peut être reglé en une a deux séance) tout en croyant ses mêmes femmes capable de manipulation mentale. Les études ont prouvées que c’est après 3 à 9 ans que les propos des enfants et des mères sont retenu avec des preuves irréfutables complétant les premières dénonciations.