Article mis à jour le 10 août 2025.
Vous êtes nombreux, en tant qu’employeurs particuliers, à employer une femme de ménage, une assistante de vie, une baby-sitter ou même un jardinier.
Grâce au CESU (Chèque emploi service universel), vous pouvez faire appel à un(e) employé(e) de maison dans de nombreux domaines (voir liste de l’article D7231-1 du Code du travail).
Exemples de métiers concernés :
-
Entretien des espaces verts : jardinier, jardinière
-
Protection du patrimoine naturel : garde-chasse, garde-pêche, garde forestier
-
Services à la personne : aide à domicile, auxiliaire de vie, assistante maternelle, baby-sitter, gouvernante
-
Autres prestations : cuisinier, coiffeur à domicile, esthéticienne, coach sportif, interprète en langue des signes…
Avantage fiscal : L’embauche d’un(e) employé(e) de maison donne droit à un crédit d’impôt de 50 % des dépenses engagées, dans la limite des plafonds prévus (voir site officiel des impôts).
Derrière cette simplicité, il existe des règles à connaître pour éviter les mauvaises surprises. Cet article répond aux questions les plus fréquentes que vous me posez quand vous venez me consulter.
1. Dois-je faire signer un contrat à mon salarié travaillant dans le cadre du CESU ?
La loi impose un contrat écrit si votre salarié travaille plus de 8 heures par semaine ou plus de 4 semaines consécutives dans l’année.
Il est conseillé de faire signer un contrat. Ce contrat peut éviter bien des malentendus : horaires, congés, jours fériés, rémunération… tout est clair dès le départ.
Sur le site du CESU vous trouverez des modèles de contrat de travail: CDI
L’annexe I de la convention collective applicable propose aussi un modèle de contrat de travail à durée indéterminée: CDI convention collective.
3. Les congés payés
Tous les salariés à domicile y ont droit. La Convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 réglemente la prise de congés, sa durée, sa rémunération à l’article 16.
-
Si vous payez via le CESU : il faudra rémunérer les congés payés. Si vous avez opté pour le chèque emploi service, le salaire horaire net convenu est majoré de 10% au titre des congés payés. Il n’y a donc pas à rémunérer les congés payés au moment où ils sont pris.
-
Si vous payez hors CESU : vous rémunérez les congés au moment où ils sont pris.
4. Et pour les jours fériés ?
-
Le 1er mai est particulier (article 18 de la convention collective) : s’il n’est pas travaillé, il doit être payé. S’il est travaillé, le salarié est payé double. Attention, le gouvernement souhaite réformer ce jour férié et pouvoir faire en sorte que les salariés dans certains secteurs puissent travailler sans être payé double, voir à ce sujet mon article sur Actu-Juridique.
-
Pour les autres jours fériés, le principe est que lorsqu’ils ne sont pas travaillés, vous ne devez pas les rémunérer SAUF si le salarié réunit certaines conditions d’ancienneté, de nombre d’heures travaillées…
(Les jours fériés ordinaires ne sont pas obligatoirement chômés et payés. Décidé par l'employeur, le chômage des jours fériés ordinaires tombant un jour habituellement travaillé ne pourra être la cause d'une diminution de la rémunération si le salarié remplit les conditions suivantes : - avoir 3 mois d'ancienneté chez le même employeur ; - avoir été présent le dernier jour de travail qui précède le jour férié et le premier jour qui lui fait suite, sauf autorisation d'absence préalablement accordée ; - s'il travaille à temps complet (40 heures par semaine), avoir accompli 200 heures de travail au moins au cours des 2 mois qui précèdent le jour férié ; - s'il travaille à temps partiel, avoir accompli un nombre d'heures réduit proportionnellement par rapport à un horaire hebdomadaire de 40 heures. Lorsque le jour férié est travaillé, il est rémunéré sans majoration.)
5. Si mon salarié est malade ?
Vous ne devez pas maintenir son salaire, mais vous devez remplir une attestation pour l’Assurance Maladie.C’est elle qui, sous certaines conditions, versera des indemnités journalières à votre salarié.
6. Rupture conventionnelle ou démission : comment ça marche ?
La rupture conventionnelle est possible avec le CESU, mais il faut l’accord des deux parties.
Elle donne droit à une indemnité minimum dont le calcul est le même que l’indemnité de licenciement (indemnité légale 1/4 de mois de salaire brut par année d’ancienneté jusqu’à 10 ans d’ancienneté et 1/3 de mois de salaire brut par année d’ancienneté au delà de 10 ans d’ancienneté).
Si vous acceptez la rupture conventionnelle, sachez qu’un forfait social s’appliquera sur l’indemnité de rupture conventionnelle d’un montant de 20% et si vous avez convenu d’une indemnité supra légale ( somme au-dessus de l’indemnité légale due), il faudra payer la CSG et CRDS.
Sur la question de la rupture conventionnelle, le gouvernement envisage aussi de la réformer et d’allonger le différé pôle emploi et raccourcir la durée d’indemnisation: voir mon article sur Actu-Juridique.
Si vous refusez, votre salarié peut démissionner, mais dans ce cas, pas de droits au chômage, en effet la rupture conventionnelle est une rupture qui se « fait à deux ».
7. Abandon de poste : comment réagir ?
Si votre salarié cesse de venir travailler sans prévenir, ce qui arrive fréquemment. J’ai pu constater que souvent les employées de maison et particulièrement les baby-sitters partaient sans démissionner, sans rien demander et reviennent quelques mois plus tard pour obtenir leur attestation France Travail.
Si ce cas se présente et que votre salariée vous dit qu’elle ne viendra plus travailler ou qu’elle ne se présente plus à son travail :
-
Envoyez lui une lettre de mise en demeure de reprendre son poste.
-
Sans réponse, engagez une procédure de licenciement pour faute grave ou vous pouvez aussi lui adresser son attestation France Travail avec la mention présomption de démission qui ne donne pas droit aux allocations chômage (mais c’est déconseillé du fait de l’insécurité juridique de cette nouvelle et dangereuse notion)
Le choix entre ces deux solutions (licenciement pour faute grave ou présomption de démission) dépendra de vos relations avec votre salariée, est ce que les relations longues étaient longues et presque amicales ou les relations étaient de courtes durées et conflictuelles.
Si elle a abandonné son poste du jour au lendemain, on peut craindre que les relations entre vous soient tendues.
8. En cas de vol ou de faute grave
Même si les faits sont évidents, vous devez respecter la procédure : convocation à un entretien, envoi d’une lettre de licenciement, remise des documents de fin de contrat.
En cas de faute grave, aucune indemnité n’est due.
9. Les documents à remettre en fin de contrat
À la fin de la collaboration, vous devez fournir :
-
Un reçu pour solde de tout compte
-
Une attestation Pôle emploi (France Travail désormais)
Ces documents sont indispensables pour que votre salarié puisse faire valoir ses droits. Il arrive souvent que les particuliers employeurs ne remettent pas ces documents à leur salarié car ils ont du mal à les remplir. Si tel est votre cas, vous pouvez vous rendre sur le site du CESU, des modèles y figurent (je les ai mis en lien sur les documents mentionnés) et pour attestation France Travail, le site de France Travail est très bien fait et vous guide pas à pas pour établir votre attestation.
10. Et si un litige survient ?
Un salarié peut contester son licenciement ou réclamer des salaires impayés devant le Conseil de prud’hommes.
Dans ce cas, mieux vaut consulter un avocat pour vous défendre au mieux. Souvent ce genre de dossiers se négocient et se règle devant le Bureau de conciliation et d’orientation du Conseil de Prud’hommes.
En conclusion
La réglementation relative aux employés de maison est simplifiée par rapport à la réglementation applicable aux autres salariés mais elle demeure complexe pour les employeurs et les salariés qui n’ont aucune connaissance juridique ou qui ne sont pas habitués aux formalités administratives.
Il est donc conseillé de vous faire conseiller par un avocat lorsque vous rencontrez des difficultés avec votre salariée ou que vous souhaitez rompre son contrat de travail.
Lisez bien aussi le site du CESU qui regorge d’informations précieuses.
Pour finir dernier conseil : pensez à souscrire une assurance protection juridique avant tout litige, dès que vous avez engagé votre salarié ce qui vous permettra de bénéficier des conseils d’un avocat pris en charge (tout ou en partie) par votre assurance.
Je termine cet article sur une note d’humour, pour ceux qui ont moins de 20 ans, vous ne connaissez sans doute pas cette célèbre publicité avec Marie Pierre Casey, incarnant une femme de ménage, « qui ne fera pas cela tous les jours ».



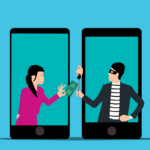
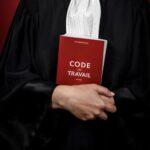


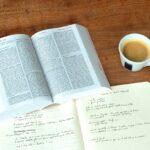

Guyon
20 décembre 2024 — 17:29
Toujours dans le sens des employeurs, moi je viens de me faire virer après deux ans de bons services sans contrat car Mme Monique ne voulait pas m’en faire, licenciée comme une m…. car j’ai mis trop de temps pour refaire les poches de son jean. Aucuns documents remis, mon salaire versé 15 jours après et je ne trouve aucunes informations qui pourraient M’AIDER.
Michèle Bauer
10 août 2025 — 23:27
Madame, j’ai écrit cet article pour justement aider les particuliers employeur à respecter vos droits de salariée de particulier d’employeur. Vous avez la possibilité de saisir le conseil de prud’hommes si vous n’avez pas reçu vos documents de rupture, et ceci en référé. Vous pouvez vous renseigner auprès de la Maison de l’avocat de votre ville si des consultations gratuites sont organisées, vous pouvez aussi bénéficier de l’aide juridictionnelle si vos revenus ne sont pas suffisants, c’est l’Etat qui réglera votre avocat s’il accepte de travailler à ce titre.